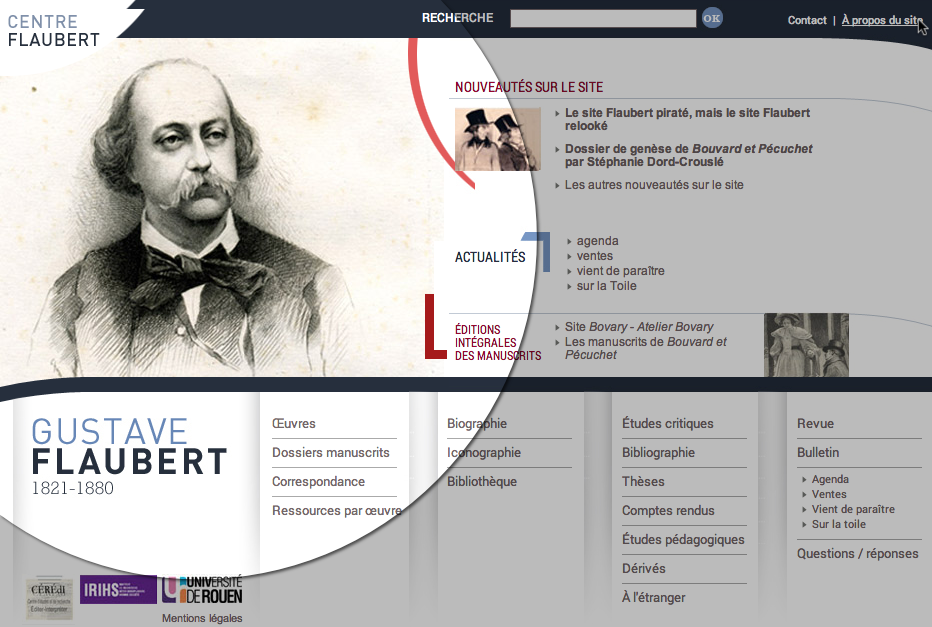Parmi les contes que Nanon montait nous débiter pour bercer notre fièvre, il s’en trouvait parfois d’assez extraordinaires et plutôt faits pour surexciter un esprit malade que pour apaiser un enfant nerveux ; mais Nanon n’y entendait pas malice ; elle racontait son histoire telle qu’elle la savait, tout à trac, au hasard de son répertoire, et on eût bien contristé la pauvre fille si on lui avait dit qu’elle avait augmenté la fièvre de l’un de nous.
Parmi ces bizarres racontars, il y en avait deux surtout qui me donnaient la chair de poule et me faisaient aussitôt enfoncer dans mon lit, le drap ramené sur mes épaules, avec des frissons délicieux ; c’était l’histoire de Mme Gorgibus et l’aventure de la bonne Gudule.
Je transcris :
Mme Gorgibus était d’allures un peu mystérieuses. C’était une petite vieille casanière et maniérée et toujours attifée de mantes à capuches, d’étoffes à ramages et de capelines extravagantes à la mode du siècle dernier et qui lui donnaient l’air d’un carême-prenant ; elle faisait la joie des gamins du quartier et les délices des petits commerçants de la ville, qu’ébaubissaient ses façons de la vieille cour. Elle vivait seule dans une ruelle voisine des remparts, en un logis assez poudreux, car elle n’avait point de servante, et, tôt levée comme les personnes de son âge, elle musait et voltigeait entre ses quatre murs, effleurant du plumeau quelques rares bibelots encrassés de poussière et guerroyant peu avec celle des meubles ; vers dix heures, elle s’aventurait pour aller aux provisions ; c’était, à vrai dire, plutôt un prétexte à révérences et à courtoisies avec les étalières du marché, car elle se nourrissait de rien ou presque, du laitage pour ses chats, et, pour elle, un fruit, quelque légume, et, chez le boulanger, une moitié d’échaudé, comme pour un oiseau.
A midi sonnant elle réintégrait le logis pour en sortir à une heure, toujours en tenue du matin, et promener sur les remparts ses trois chats blancs, trois amours de minets enrubannés de noeuds de satin à grosses coques et l’air, dans leur attifage grotesque, de trois petites Madame Gorgibus : elle veillait minutieusement à ce que Frimousse, Triste-à-Patte et Blanchette fissent dehors leurs besoins et, cet événement accompli, la famille rentrait à la maison où Mme Gorgibus procédait alors à des bichonnages savants.
Cela prenait bien quelques heures, mais par les beaux soleils de fin mai et juin, pompeusement vêtue de vieilles nippes et de lumineuses loques, Mme Gorgibus, rengorgée dans des mantes de nuances attendries, s’acheminait à petits pas vers les quinconces, la promenade à la mode où toute la ville se rencontre sous les plus beaux tilleuls du monde aux bords des eaux calmes et bleues de l’Adour.
Elle n’y faisait plus sensation, la vieille masque, à peine peur aux enfants bien élevés : on l’avait tant vue et revue ! Mais elle y rencontrait une autre vieille originale qui avait eu des revers de fortune, elle aussi, et vivait à l’extrémité opposée de la ville, dans le quartier des Capucins.
C’était une dame de la noblesse, mais elle ne recevait plus personne, ne rendait visite à qui que ce fût, vivait tout à fait retirée du monde ; d’ailleurs elle demeurait trop loin, ses vieilles jambes l’auraient trahie ; et puis, un peu hautaine, elle n’avait cure d’initier à sa misère, même sa bonne Gorgibus qui, curieuse, avait fait longtemps le siège du logis.
Elles se rencontraient sous les tilleuls de la promenade et passaient ensemble de longues heures avec, autour d’elles, la société de la ville, dont Mme de la Livadière connaissait par le menu toutes les histoires, depuis au moins cent ans, et cela devant ce merveilleux paysage des rives de l’Adour. Que leur fallait-il de plus, à ces deux vieilles chéries ? Elles se voyaient encore le dimanche à la messe, aux vêpres et au salut de leur bonne cathédrale, et, les mois d’hiver, quand le froid piquant ne permet plus les longues séances au bord de l’eau, sur les bancs des promenades, elles avaient trouvé le moyen de se rencontrer encore.
C’était chez une chocolatière de la rue des Bûchettes, à l’ombre même de la cathédrale : une petite boutique toute en boiseries blanches et en hautes glaces striées de chiures de mouches, une chocolaterie du siècle dernier, démodée comme ses deux clientes, et qu’en dehors des enfants pressés d’acheter un sou de chocolat après la messe, personne ne fréquentait plus. Les tablettes enveloppées de papier d’étain y blanchissaient tristement au fond de vitrines à ornements sculptés, à côté de papillotes, de surprises et de sucres de pomme, dont les images coloriées s’effaçaient de plus en plus.
De quoi vivait la vieille dame qui présidait à ce comptoir ? La province a de ces mystères. C’était une petite vieille à robe de soie noire élimée, bien propre avec une éternelle fanchon de dentelle sur sa coiffure en boucles, des boucles argentées mêlées de fils jaunissants et qui, l’étrange créature, trouvait le moyen, les belles journées de gelée, de servir à Mmes Gorgibus et de la Livadière, pour la somme de trente centimes la tasse, un chocolat, ma foi, parfumé, vanillé et fumant. Ces dames, avec mille simagrées, le buvaient à petites gorgées, complimentaient la boutiquière, se faisaient leurs confidences, et puis, après quelques bonne ma chère, mon coeur d’oiseau et tendre pigeon, payaient strictement, chacune, leurs six sous et se retiraient avec une révérence, que c’en était délicieux et touchant.
Là, après quelques salamalecs, il fallait bien se séparer : la nuit tombe vite en hiver. On se donnait rendez-vous pour la première belle journée, et Mme de la Livadière, appuyée sur sa canne à béquille d’ivoire, de regagner lentement son logis de la haute ville, et Mme Gorgibus sa ruelle des remparts, dans le quartier des Catalans.
Et c’était fini pour la journée. Une fois rentrée, Mme Gorgibus ne sortait plus : c’étaient les apprêts du souper, sa sieste de cinq à huit, avant le potage à petites cuillerées, puis la lecture dans un vieil almanach, la soirée, le coucher, la nuit.
Comment une existence aussi inoffensive put-elle attirer les haines de tout un quartier ? Ses capotes extravagantes, ses modes de l’autre temps et ses somptueuses loques la firent d’abord traiter de vieille folle ; de vieille folle, on glissa vite à vieille fée. Appuyées sur leurs balais, les commères de la ville ne se gênaient pas d’un seuil à l’autre pour rire et se signaler le passage de ce vieux masque en catogan. Et puis Mme Gorgibus était fière, un peu repliée sur elle-même et, en dehors des fournisseurs, n’adressait la parole à personne ; pis, elle n’ouvrait sa porte à qui que ce fût. Que pouvait-elle bien fabriquer dans ce logis mystérieux avec ses trois chats ? Ces trois chats enrubannés comme des mariées aggravèrent la situation : cela n’était pas naturel. Que faisaient-ils toujours en permanence, assis devant cette chaudière, et quelle cuisine du diable y surveillaient-ils donc ?
On prononça le mot de sorcière, mais le corbeau apprivoisé perdit tout.
Ce vieux corbeau éternellement en sentinelle dans l’angle de la fenêtre acheva de surexciter les esprits. Il était de mine rébarbative, menaçante même, avec son gros bec, son oeil rond à moitié endormi ; mais on sentait en lui une âme vigilante, et son aspect terrifiait les passants ; jamais bon chrétien n’avait vécu dans l’intimité de pareille bestiole ; il devait servir à quelque maléfice et avait sûrement fréquenté le sabbat ; une trame d’affreux soupçons se resserrait de jour en jour autour de Mme Gorgibus.
Elle était loin de s’en douter, la pauvre vieille à cervelle de poupée, et continuait son humble et machinale existence au milieu de l’hostilité de tous. Vieille, pauvre, isolée, sans défense et sans grande idée, elle devait être tôt ou tard victime d’un vilain tour ; quelques gamins toujours prêts à mal faire s’y crurent un jour autorisés. Épiée, espionnée comme elle l’était, ils eurent vite fait de profiter de son absence et d’ouvrir sa porte fermée au loquet, car la pauvre était sans défiance.
A peine dans la place, ils s’emparaient des trois minets qui, tout engourdis de paresse ne résistèrent même pas ; leur nouer solidement la queue avec des ficelles autour de l’anse du pot-au-feu, fut pour eux l’affaire d’une minute ; les trois bêtes stupéfiées ne bougèrent d’abord pas, mais dès que la flamme du foyer leur caressa trop les côtes, ce furent des soubresauts de damnés, et jurant, miaulant, crissant à travers la chambre, les trois bêtes, en une prestigieuse gambade, entraînèrent au beau milieu du logis la marmite qui s’y renversa ; le lait se répandit qui les ébouillanta, ici redoublement de cris et de miaulements, de plaintes et de râles dont les garnements ne se tenaient pas de joie ; maintenant les chats enragés se dévoraient entre eux.
Cependant les deux plus âgés de la bande n’avaient pas perdu leur temps ; ils avaient jeté une couverture sur le corbeau qui asséna quelques bons coups de bec et, lui, se défendit ; mais ils eurent tôt fait de lui envelopper la tête, de le maintenir entre leurs jambes et en un tour de main, clic, clac, ils plumèrent tout vif le malheureux oiseau palpitant.
En un clin d’oeil, maître corbeau fut nu comme un ver, très indécent et très fantastique avec ses longues cuisses grenues, son estomac en forme de proue et la peau grise et granulée de son pauvre corps tout grelottant : une bête de sabbat, un gnome, un vampire.
Figé par la douleur, il s’était réfugié dans un coin où il ne bougeait plus, claquant seulement du bec, stupide ; et nos gamins prirent la fuite.
Là-dessus, Mme Gorgibus s’amène en trottinant, en mantelet de soie ventre de puce, introduit sa clef dans sa serrure et pénètre dans son logement. Quel sabbat ! quel désastre ! Assourdie de râles et de rugissements, elle trébuche sur une marmite où s’enlacent, s’étreignent et se dévorent trois bêtes de l’apocalypse aux poils hérissés et gluants : l’une lui griffe la main d’une longue estafilade, l’autre lui mord le mollet à pleines dents, et tandis qu’éperdue elle appelle au secours sans pouvoir trouver un cri dans sa gorge, un oiseau de cauchemar, un animal fantôme, livide, obscène, avec deux ailerons de chair grise, se précipite sur elle, le bec largement ouvert, et tente de lui grimper à la taille en sautelant. Mme Gorgibus put heureusement retrouver sa porte ; elle s’enfuit en criant à travers la nuit, mais son peu de raison sombra dans l’aventure. Mme Gorgibus devint folle, elle finit ses jours aux Petites-Maisons.
Jean Lorrain, Histoires de masques, 1900